Mémoire & retour d’expérience | Crue / Inondation

Sur le territoire des Vallées des gaves, les eaux en furie emportent maisons, ponts, routes, et plongent des villages comme Barèges, Luz-Saint-Sauveur, Gavarnie ou Cauterets dans l’isolement total. La violence de cet épisode météorologique laisse des paysages de désolation et suscite une vive émotion parmi les habitants. Ce territoire, drainé par le bassin versant du gave de Pau dans sa partie bigourdane (Hautes-Pyrénées), subit l’une des crues les plus dramatiques de son histoire récente. La sidération s’installe, d’autant que cet épisode survient seulement huit mois après une crue déjà notable en octobre 2012, d’occurrence vicennale, ayant inondé une première fois la ville de Lourdes.
La crue de juin 2013 résulte d’une rare conjonction de facteurs climatiques et météorologiques, rendant l’évènement inéluctable :
Lorsque l’épisode pluvio-orageux se déclenche le 17 juin dans un flux de sud rapide, les gaves sont déjà proches de leur cote d’alerte. Les températures estivales des jours précédents ont en effet amorcé la fonte rapide du manteau neigeux, et les 100 à 200 mm de pluie généralisés tombés en moins de 48 heures agissent comme un détonateur. Les cours d’eau gonflent brutalement, sortent de leur lit et, dans un élan incontrôlable, ravagent tout sur leur passage.
Les dommages sont colossaux. Habitations, commerces, campings, thermes, routes, infrastructures publiques et réseaux essentiels (eau potable, électricité, gaz) subissent des dégradations majeures. La crue emporte avec elle une vingtaine d’habitations et de bâtiments à usage économique ainsi que plus de 60 hectares de terres agricoles. La destruction de ponts et de routes empêche toute circulation dans plusieurs vallées, à l’image de celle du Bastan, qui se retrouve totalement coupée du monde de manière semblable à la crue du 2 juillet 1897.
À Lourdes, le bas de la ville à forte vocation hôtelière et commerçante est envahi par plus de deux mètres d’eau, dépassant les niveaux de la crue d’octobre 1937 qui faisait jusqu’alors référence absolue. Des images marquantes montrent les rues transformées en canaux, des voitures emportées, et des touristes évacués en urgence. Plusieurs milliers de personnes doivent quitter leur hôtel ou leur domicile, parfois dans la précipitation. Les autorités évacuent notamment le sanctuaire de Lourdes, une décision rare dans l’histoire du site.
Malheureusement, deux victimes sont à déplorer, à Luz-Saint-Sauveur et à Pierrefitte-Nestalas. Le bilan humain, bien que relativement limité, ne reflète pas l’intensité dramatique de la catastrophe, qui a bouleversé la vie de milliers de personnes.
L’impact économique est également très lourd. La fréquentation touristique, pilier de l’économie locale, s’effondre dans les mois qui suivent. À l’échelle locale, les pertes économiques directes sont estimées à 150 millions d’euros et les pertes d’exploitation à plus de 100 millions. Certaines entreprises touristiques, hôtelières ou agricoles ne s’en relèveront jamais.
Au lendemain de la crue, les habitants redécouvrent leurs vallées métamorphosées. Le paysage est bouleversé, comme reconfiguré par la force des eaux. Les graviers, galets, blocs et bois charriés par les torrents se sont accumulés sur de larges étendues. Le transport solide massif devient l’un des signes distinctifs de cette crue morphogène qui répand plusieurs centaines de milliers de m3 de matériaux sur les cônes de déjection des gaves.
Les berges sont arrachées, les lits déplacés, les digues emportées. Des aménagements pourtant considérés comme résistants sont endommagés : ponts, centrales hydroélectriques, protections en enrochements… rien ne résiste à la puissance des gaves en furie.
Cette catastrophe souligne de manière brutale la vulnérabilité des territoires de montagne face aux crues torrentielles et l’importance d’adopter une gestion intégrée des risques. Elle met en lumière les limites des ouvrages de protection et la nécessité de prendre en compte le comportement naturel des cours d’eau dans les politiques d’aménagement : les torrents ont besoin d’espace pour respirer sans menacer les enjeux humains.
Si le phénomène a été relativement bien anticipé, permettant aux communes de déclencher leur Plan communal de sauvegarde (PCS) pour alerter et mettre à l’abri habitants et touristes de passage, il a démontré le besoin de disposer d’informations hydrologiques sur les têtes de bassin, en complément du réseau Vigicrues.
Malgré tout, cet évènement a révélé une capacité de mobilisation collective remarquable. Dans l’urgence, collectivités, habitants, services de secours et bénévoles venus de tous horizons ont agi avec une grande solidarité. Sous la coordination d’une mission post-crue animée par les services de l’État, l’ensemble des acteurs a ainsi permis de reconstruire très rapidement le territoire qui a bénéficié d’un soutien financier considérable de l’État, de la Région Occitanie, du Département des Hautes-Pyrénées et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Cette dynamique s’est consolidée dans les mois suivants avec le lancement du premier Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de 16 M€ à l’échelle du bassin du gave de Pau bigourdan. Par la suite, la création du syndicat mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des gaves (PLVG) né de la fusion de structures existantes aux compétences morcelées, favorisera le portage de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) à une échelle hydrographique cohérente. Cette gouvernance renouvelée s’est traduite par la mise en œuvre d’outils de gestion des cours d’eau opérationnels et ambitieux, intégrant des actions de restauration morphologique et de sensibilisation des populations. L’objectif était clair : mieux concilier la sécurité des biens et des personnes avec le fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Dix ans après la catastrophe, le PLVG a souhaité inscrire la crue dans la mémoire collective à travers une semaine de commémoration organisée en juin 2023. Enfants, habitants, élus et professionnels du territoire ont été invités à participer à des animations, expositions, ciné-débats, et village de la prévention afin d’entretenir la vigilance et maintenir les consciences éveillées face à ces phénomènes. Ces actions de sensibilisation sont appelées à se renouveler pour favoriser la résilience du territoire.

À travers les témoignages poignants des habitants, des secouristes, des élus et des techniciens, ce film documentaire retrace l’histoire de cette catastrophe naturelle hors normes. Images d’archives, vidéos amateurs et animations permettent de comprendre comment un simple épisode pluvieux s’est transformé en un évènement bouleversant le quotidien et marquant la conscience collective.
Entre douleur, solidarité et résilience, le film documentaire « La crue du 18 juin 2013 » interroge aussi notre rapport aux cours d’eau et aux choix d’aménagement du territoire. Un récit humain et sensible sur la force brute de la nature et la capacité d’une vallée à se relever d’un évènement mémorable.
Ce documentaire a été lauréat des Greens Awards de Deauville, festival international du film responsable, en remportant un trophée d'argent en 2018.
Réalisation : Obatala
Production : PLVG
Financement : État, Agence de l’eau Adour-Garonne
Durée :
À visionner ici : http://inondations.valleesdesgaves.com/le-film
// Article paru dans la revue "Risques Infos" n°48, mai 2025, à consulter ici ou là :






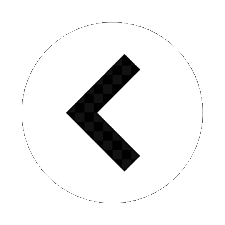
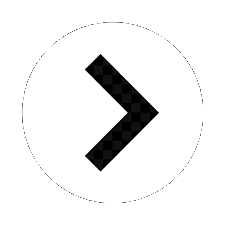
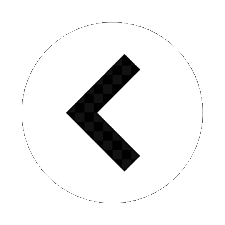
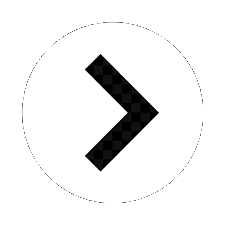
Ou inscrivez vous
x Annuler